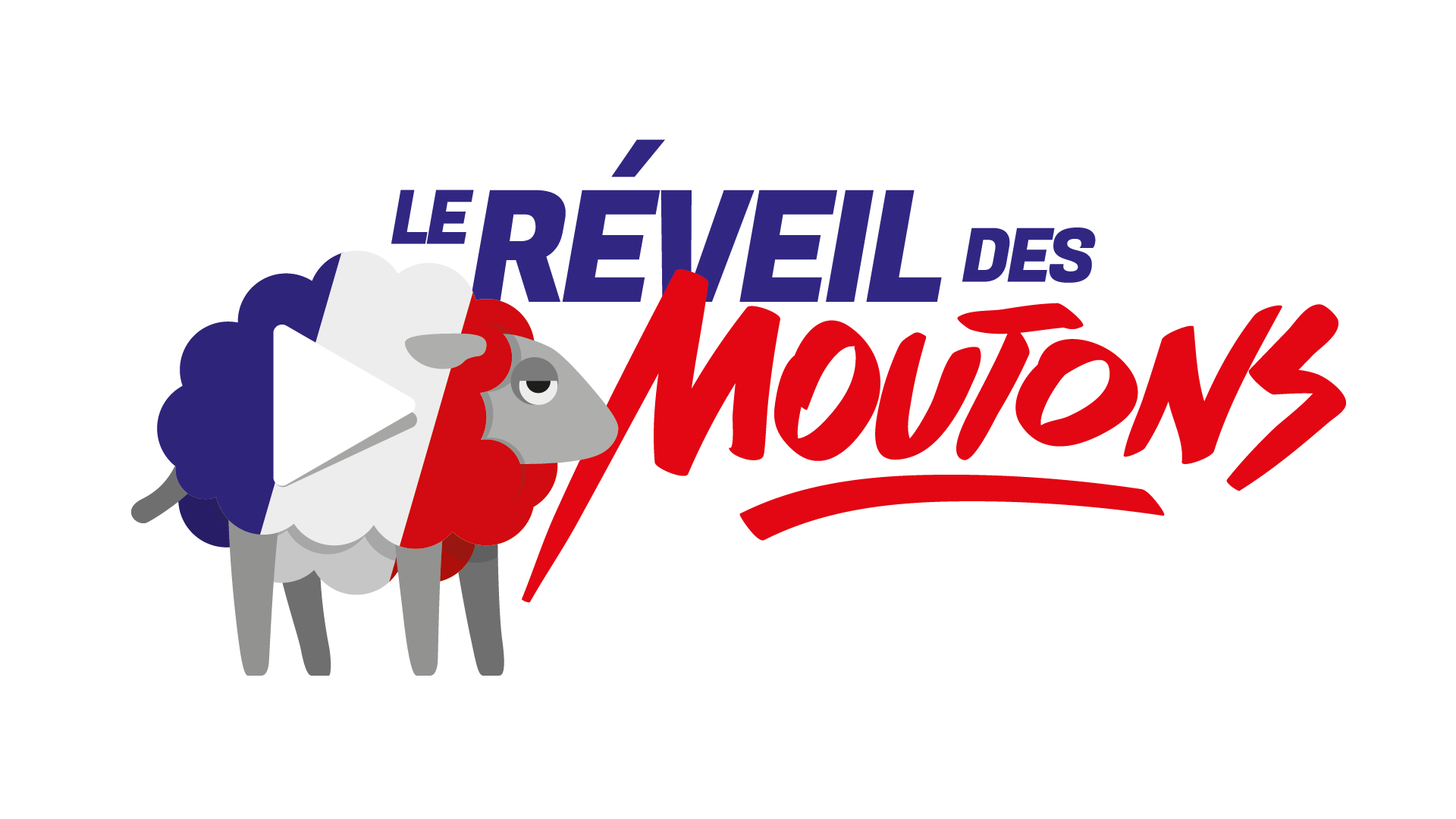Le nouveau despotisme en matière de santé publique

30268 Views
Des règles draconiennes suppriment notre humanité
Par Matthew Crawford le 25 octobre 2021
Je vis dans la région de la Baie, dans un comté où le taux de vaccination est de l’ordre de 80 %. Fin juillet, je déposais ma fille cadette à un camp de jour de football chaque matin. Il y avait 10 enfants qui couraient autour d’un terrain ouvert. Ils portaient des masques pendant six heures chaque jour, et il faisait environ 85° cette semaine-là. En disant à ma fille entièrement vaccinée de mettre ce truc, je me suis sentie compromise pour avoir participé à cette mascarade. La vieille belligérance écossaise et irlandaise a commencé à se manifester.
Les règles sont censées codifier une partie de la vérité rationnelle et la rendre efficace. De nos jours, nous nous trouvons dans des situations où, pour faire ce qui est vraiment rationnel, il faut peut-être enfreindre les règles d’une institution. Mais faire cela, c’est inviter à la confrontation. Il se peut que vous ayez à mener une lutte interne pour décider du degré de résistance à opposer. Insister sur les raisons, c’est faire preuve d’entêtement, et vous voulez être sociable. Vous vous dites qu’il ne sert à rien de vous confronter au personnel du YMCA qui ne fait qu’exécuter les ordres. Il n’y a personne de visible à qui vous pouvez adresser vos raisons, personne à qui vous pouvez demander des comptes.
Au bout d’un an et demi, cela devient une habitude. Si vous défiez l’ordre du masque et que vous êtes mis au défi par quelqu’un qui fait son travail selon les instructions, il y a de fortes chances que vous reculiez et que vous vous soumettiez à l’ordre, ce qui est pire que si vous l’aviez fait dès le départ. Même si vous soupçonnez fortement que la peur du virus a été attisée de manière disproportionnée pour servir des intérêts bureaucratiques et politiques, ou comme un artefact du modèle commercial alarmiste des médias, vous pouvez subtilement ajuster votre vision de la réalité de Covid pour la rendre plus conforme à votre comportement réel. Vous pouvez réduire la dissonance de cette manière. L’alternative est d’être confronté chaque jour à de nouveaux exemples de votre propre avarice.
Dans la formule de Hobbes, le Léviathan s’appuie sur la peur pour supprimer l’orgueil. C’est l’orgueil qui rend les hommes difficiles à gouverner. Il peut être éclairant de voir notre moment Covid à travers cette lentille et de considérer comment de petits moments d’humiliation peuvent être mis au service d’un projet politique de longue date, ou y trouver leur sens et leur force normative.
Plus précisément, jouer son rôle dans le théâtre du Covid, comme dans le théâtre de la sécurité à l’aéroport, c’est subir l’humiliation unique d’un être rationnel qui se soumet à des moments de contrôle social qu’il sait fondés sur des contre-vérités. Le fait que celles-ci soient exprimées dans le langage de la science est particulièrement irritant.
Nous devons considérer les positions intellectuelles de bonne foi qui ont graissé les patins de notre glissement vers une forme illibérale de gouvernance. En effet, outre l’opportunisme politique entourant le Covid, des efforts bien intentionnés ont été déployés pour contrôler la pandémie en modifiant le comportement des gens. La question est la suivante : quels étaient les moyens employés pour y parvenir, et quelle était la vision des êtres humains qui rendait ces moyens attrayants ? Ce que nous avons obtenu, en fin de compte, sans que personne ne le veuille vraiment, peut être qualifié à juste titre d’État propagandiste qui cherche à manipuler sans persuader.
Ici, la « science » peut être carrément antiscientifique, selon les circonstances. Le mot ne désigne pas un mode de recherche, il est plutôt invoqué pour légitimer le transfert de souveraineté d’organes démocratiques à des organes technocratiques, et comme un dispositif pour isoler ces transferts du domaine de la contestation politique. Peut-on concilier cela avec l’idée de gouvernement représentatif ?
Philip Hamburger, professeur de droit à Columbia, écrit sur l’État administratif. Il s’agit d’un vaste ensemble d’agences exécutives qui se donnent le pouvoir de soumettre les gens à des obligations contraignantes sans recourir à la législation, en contournant la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution. En théorie, seul le Congrès peut faire des lois. Ses membres sont soumis au processus démocratique, ils doivent donc persuader leurs électeurs, et les uns les autres. Mais à mesure que l’État administratif s’est métastasé, supplantant le pouvoir législatif du corps législatif, des bureaucrates non élus définissent de plus en plus les contours de la vie moderne sans avoir à rendre de comptes. Ils fondent leur légitimité sur des revendications d’expertise plutôt que sur un alignement sur les préférences populaires. Cette trajectoire a débuté il y a un siècle, à l’époque du Progrès, et a connu de grandes avancées pendant le New Deal et la Grande Société.
Hamburger replace cette évolution dans le contexte historique d’autres formes de pouvoir non responsable, comme la fameuse chambre étoilée de Jacques Ier : « Toujours tentés d’exercer plus de pouvoir avec moins d’efforts, les dirigeants se contentent rarement de gouverner par le biais de la loi, et dans leur désir inquiet d’échapper à ses voies, beaucoup d’entre eux essaient de travailler par le biais d’autres mécanismes. »
Le « désir agité d’échapper » aux inconvénients de la loi est celui auquel les progressistes sont particulièrement enclins dans leur aspiration à transformer la société : les majorités d’opinion simplement existantes, et les possibilités législatives qu’elles circonscrivent, n’inspirent généralement pas la déférence mais l’impatience.
C’est en tant qu’êtres capables de raison que le pouvoir législatif est censé nous « représenter ». Le pouvoir judiciaire nous considère de la même manière. Lorsqu’un tribunal rend une décision, le juge rédige une opinion dans laquelle il explique son raisonnement. Il fonde sa décision sur la loi, les précédents, le bon sens et les principes qu’il se sent obligé d’énoncer et de défendre. C’est ce qui transforme la décision de simple fiat en quelque chose de politiquement légitime selon les prémisses du gouvernement républicain, capable d’obtenir l’assentiment d’un peuple libre. C’est ce qui fait la différence entre le simple pouvoir et l’autorité.
Les années 90 ont vu la montée de nouveaux courants dans les sciences sociales qui ont souligné l’incompétence cognitive des êtres humains. Le modèle de l' »acteur rationnel » du comportement humain (une prémisse simpliste qui avait sous-tendu le parti du marché pendant le demi-siècle précédent) a été renversé par l’école plus psychologique de l’économie comportementale, qui enseigne que nos actions sont en grande partie guidées par des biais cognitifs et heuristiques pré-réfléchis. Ces biais tendent à être fonctionnels, à la fois dans le sens où ils reflètent des modèles généraux de la réalité et parce qu’ils offrent des substituts « rapides et frugaux » à la délibération, qui est une activité lente et coûteuse. On trouve une pensée voisine chez des auteurs phénoménologiques tels que Merleau-Ponty et Hubert Dreyfus : le type de pensée qui consiste en des chaînes d’énoncés propositionnels et d’inférences logiques est un cas spécial, non typique des animaux dotés d’un corps. Nous sommes l’un de ces animaux, et notre façon quotidienne d’appréhender le monde doit avoir une certaine fluidité, si nous ne voulons pas être paralysés.
Les développements de la psychologie qui ont donné naissance à l’économie comportementale ont fourni une révision nécessaire à notre compréhension de la personne humaine, dans le sens du réalisme. En effet, l’anthropologie étroitement économiste de l' »acteur rationnel du marché » du choix de soi était inadéquate.
Dans leur livre Nudge, Richard Thaler et Cass Sunstein soulignent que les choix individuels ne se font généralement pas dans le vide. Ils sont souvent sculptés par une « architecture de choix » qui peut être plus ou moins délibérée dans sa conception, mais qui opère généralement sous le seuil de la conscience, comme une sorte d’échafaudage cognitif de fond. Un exemple classique est le placement des articles dans les rayons d’une épicerie. Les articles à forte marge ont tendance à être placés à hauteur des yeux, tandis que les achats impulsifs sont placés dans la file d’attente de la caisse, qui se déplace lentement. Les céréales sucrées sont placées à la hauteur des yeux d’un enfant, afin qu’il harcèle sa mère pour avoir des Lucky Charms.
Pourquoi ne pas exploiter le pouvoir de l’architecture du choix pour le bien public, et remplacer les Lucky Charms par des choux de Bruxelles ? Cette solution présente un intérêt évident. C’est un moyen non coercitif d’améliorer le comportement des gens sans avoir à les persuader de quoi que ce soit. Cela constitue un encouragement évident pour les tendances paternalistes de l’État administratif. À la suite de la publication de Nudge en 2009, la Maison Blanche d’Obama et le gouvernement de David Cameron au Royaume-Uni ont créé des unités « nudge » pour mettre en pratique les idées de l’économie comportementale. Les exemples que les « nudgers » aiment à donner pour illustrer leurs techniques ne prêtent pas à controverse : il s’agit d’augmenter le taux d’épargne ou d’inciter les gens à arrêter de fumer.
Comme Thaler et Sunstein aiment le souligner lorsqu’ils sont sur la défensive, ils n’ont pas inventé le nudging, ils lui ont simplement donné un nom et articulé ses principes dans le langage des sciences sociales. Mais cette articulation a eu des conséquences très importantes. Lorsqu’une chose banale est présentée comme une découverte scientifique, elle devient accessible aux institutions, faisant partie de leur boîte à outils pour les « interventions fondées sur des preuves« .
Des équipes « Behavioral insight » inspirées par Nudge opèrent actuellement au sein de la Commission européenne, des Nations unies, de l’OMS et, selon les calculs de Thaler, d’environ 400 autres entités dans le monde des gouvernements et des ONG, ainsi que dans d’innombrables entreprises privées. Il serait difficile de surestimer le degré d’institutionnalisation de cette approche.
Dans un entretien récent avec UnHerd, Thaler a insisté sur le fait que le nudge n’est qu’un outil, qui peut être utilisé à bon ou mauvais escient. Mais, comme pour tant d’innovations technologiques, la disponibilité de l’outil modifie l’éventail des possibilités. En effet, elle modifie la façon dont les objets du monde apparaissent à celui qui détient l’outil. L’innovation réalisée ici, à grande échelle, réside dans la façon dont le gouvernement conçoit ses sujets : non pas comme des citoyens dont le consentement réfléchi doit être obtenu, mais comme des particules à diriger par une science de la gestion du comportement qui s’appuie sur nos préjugés.
Un exemple sur lequel Thaler et Sunstein attirent l’attention, dans leurs conseils aux administrateurs, est le biais de la « norme émergente ». Les normes de diverses descriptions ont plus ou moins de prise sur nous, pour des raisons sur lesquelles on peut spéculer sans fin. Mais si vous dites aux gens qu’une nouvelle norme est en train d’émerger, ils sont plus susceptibles de s’identifier à elle. Il semble que la plupart des gens ne veulent pas être du mauvais côté de l’histoire. Annoncer l’émergence d’une nouvelle norme peut donc devenir une prophétie auto-réalisatrice, un moyen de diriger le troupeau. Cela présente un attrait évident pour les avant-gardistes. Elle semble promettre que l’on peut marquer la direction de l’histoire, et ainsi la rendre telle.
Ces avant-gardistes peuvent être des idéologues, ou simplement des acteurs institutionnels qui ont intériorisé la logique expansionniste des bureaucraties qui les emploient. L’État hygiéniste fait la propagande d’une « nouvelle normalité » faite de distanciation sociale et de dissimulation du visage. Voici une moralité médicale farfelue de l’atomisation sociale, présentée comme quelque chose d’inévitable.
Alors que l’économie se psychologisait dans les années 1990, une évolution parallèle se produisait dans les sciences politiques. Avant d’entrer dans le vif du sujet, considérons le cadre général. L’Union soviétique venait de s’effondrer. Cela a placé la « démocratie libérale » dans une situation nouvelle, ou plutôt l’a ramenée à une situation qui existait au milieu du 19e siècle.
Le libéralisme et la démocratie sont deux choses distinctes, qui ne sont pas tout à fait à l’aise l’une avec l’autre. Leurs différences ont été submergées pendant la guerre froide lorsqu’elles avaient un ennemi commun, le communisme soviétique, tout comme elles l’avaient été auparavant lorsqu’elles avaient un ennemi commun, la monarchie.
Lorsque la monarchie a finalement été éliminée en tant que rival de la démocratie lors des révolutions de 1848, l’alliance de convenance entre le libéralisme et la démocratie a menacé de se rompre. En 1861, John Stuart Mill était terrifié à l’idée que les majorités démocratiques puissent contraindre un libéralisme consistant en des « expériences de vie ». La liberté des élites éduquées d’explorer de nouveaux terrains culturels et des projets de culture personnelle nécessitait de se débarrasser des interdits religieux, ainsi que des affections et des engagements locaux par lesquels les masses s’orientaient. Le problème fondamental était qu’un tel projet libérateur obtient sa légitimité politique en s’alliant à la démocratie – d’abord contre la monarchie, puis contre le communisme.
Comme le dit Adrian Vermeule, le libéralisme craint que sa dépendance à l’égard de la démocratie et sa différence fondamentale avec elle ne soient révélées si une évolution durable de l’opinion populaire non libérale est mise en lumière. La solution consiste à proposer un concept idéalisé de la démocratie, qui se distingue nettement du « simple majoritarisme ». Grâce à cet artifice, le libéral peut préserver sa perception de lui-même en tant que démocrate. Cela peut devenir assez tendu, comme dans le réflexe de qualifier les gouvernements élus par le peuple en Pologne et en Hongrie d' »antidémocratiques ». Lorsque Pew a réalisé un sondage d’opinion en Afghanistan il y a dix ans et a constaté que quelque 95 % des personnes interrogées préféraient que la charia soit la loi du pays, cela n’a pas interrompu la conviction que rendre l’Afghanistan « démocratique » nécessiterait une transformation sociale féministe. C’est-à-dire une révolution explicitement anti-majoritaire.
Retour aux années 90. La carrière la plus en vogue pour ma cohorte d’étudiants en doctorat au département de science politique consistait à construire un édifice théorique pour renforcer le trait d’union dans « démocratie libérale », un peu comme l’ajout par Ptolémée d’épicycles et d’autres complexités au modèle géocentrique du système solaire dans le but de le sauver d’une accumulation d’observations. Les théoriciens politiques de ma génération ont fait cela sous une rubrique qu’ils ont appelée « démocratie délibérative ». À l’époque, il y avait une querelle entre Habermas et Rawls, et c’est Rawls qui a insisté sur ce point crucial : si l’on parvenait à établir les bonnes conditions d’encadrement de la délibération, le démos parviendrait à des positions libérales acceptables. Nous devrions être capables de formaliser ces conditions, pensait-on. Et inversement, chaque fois que les opinions des démos s’écartaient d’un axe allant approximativement de la page éditoriale du New York Times à celle du Wall Street Journal, on considérait que c’était une preuve prima facie de l’existence d’une influence déformante dans les conditions discursives dans lesquelles les gens menaient leurs processus de pensée ou leurs conversations entre eux. Le résultat était une opinion qui n’était pas authentiquement démocratique (c’est-à-dire pas libérale).
De toute évidence, la perspective du populisme suscitait déjà une certaine inquiétude. Soutenir la « démocratie libérale » en tant qu’unité conceptuelle nécessiterait un cadre de dialecticiens subtils travaillant à un méta-niveau sur les conditions formelles de la pensée, poussant la population à travers une opération de cadrage cognitif à mener sous le seuil de l’argument explicite. Je me souviens d’un étudiant diplômé de mon département qui menait des expériences sur des groupes de discussion, pour voir s’il pouvait les amener à penser les bonnes choses.
Pour mon œil peu compatissant, cela ressemblait à un exercice d’auto-illusion de la part d’apparatchiks en herbe pour qui une position franchement élitiste aurait été psychologiquement intenable. Je ne sais pas si cet étudiant a réussi à faire penser les bonnes choses à ses sujets. Mais je ne doute pas qu’il leur ait fait dire les bonnes pensées, leur donnant ainsi l’imprimatur démotique qu’il recherchait. Peut-être que c’était suffisant. Le politiquement correct pourrait être compris comme un dispositif devenu nécessaire pour que le libéralisme puisse continuer à revendiquer le manteau de la démocratie, même si la poursuite de son programme nécessitait des mesures de plus en plus antidémocratiques.
Il s’avère que la meilleure façon d’assurer les conditions discursives de la « démocratie délibérative », et d’installer une architecture de choix appropriée qui poussera le demos dans la bonne direction, est de conserver l’information. Bientôt, l’Internet permettra et sapera ces aspirations.
De toutes les entreprises de plateforme, Google est singulière. Son quasi-monopole sur la recherche (environ 90%) lui permet d’orienter la pensée. Et, de plus en plus, elle considère que l’orientation de la pensée est sa seule responsabilité. Dans un article important intitulé « Google.gov », le professeur de droit Adam J. White détaille à la fois les flux de personnel et les profondes affinités intellectuelles entre Google et la Maison Blanche d’Obama. Pendant huit ans, des centaines de personnes ont changé de poste, parfois à plusieurs reprises, entre cette seule entreprise et l’administration – un alignement sans précédent du pouvoir des entreprises et du pouvoir exécutif. White écrit que tous deux aspiraient à « remodeler le contexte informationnel des Américains, en veillant à ce que nous fassions des choix basés uniquement sur ce qu’ils considèrent comme le bon type de faits – tout en niant qu’il puisse y avoir des valeurs ou des politiques intégrées dans cet effort« .
L’un des principes centraux de la conception que les progressistes ont d’eux-mêmes est qu’ils sont favorables aux faits et à la science, tandis que leurs opposants (souvent la majorité) sont réputés avoir une aversion inexplicable pour ces bonnes choses : ils s’accrochent à des illusions frivoles et à des anxiétés irrationnelles. Il s’ensuit que la bonne gouvernance consiste à donner aux gens des choix informés. Ce n’est pas la même chose que de donner aux gens ce qu’ils pensent vouloir, en fonction de leurs préférences non averties. Les choix éclairés sont ceux qui ont un sens dans un contexte informationnel bien structuré.
Il existe un style épistémique distinct que la politique progressiste a adopté pendant l’engouement mutuel de Google et d’Obama. Ici, l’idée de neutralité ou d’objectivité est déployée pour affirmer une identité entre ce que les libéraux veulent faire et les intérêts du demos. Cette identité se révèle une fois que les distorsions de la réalité objective sont éliminées.
S’exprimant au siège de Google en 2007, Obama a déclaré qu’il utiliserait « la chaire d’intimidation pour leur donner de bonnes informations« . La chaire d’intimidation était auparavant comprise comme une perche d’où l’on tente de persuader. La persuasion est ce que vous faites si vous êtes engagé dans une politique démocratique. La conservation de l’information, en revanche, est ce que vous faites si vous pensez que le désaccord avec votre point de vue ne peut être dû qu’à une incapacité à traiter correctement les informations pertinentes. Un échec cognitif, en d’autres termes.
Dans la lettre des fondateurs qui accompagnait l’introduction en bourse de Google en 2004, Larry Page et Sergey Brin déclaraient que leur objectif était de « vous fournir exactement ce que vous voulez, même lorsque vous n’êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin » . Le moteur de recherche parfait ferait cela « avec presque aucun effort » de la part de l’utilisateur. Dans une mise à jour de 2013 de la lettre des fondateurs, Page a déclaré que « le moteur de recherche de mes rêves fournit des informations sans même que vous ayez à les demander. » En minimisant la participation active de l’utilisateur, Google répondra, non pas à la question que vous auriez pu poser vous-même, mais à celle que vous auriez dû poser. Comme l’a déclaré Eric Schmidt au Wall Street Journal, « [L]’idée est que de plus en plus de recherches soient effectuées en votre nom sans que vous ayez à taper. . . . En fait, je pense que la plupart des gens ne veulent pas que Google réponde à leurs questions. Ils veulent que Google leur dise ce qu’ils doivent faire ensuite. »
L’entreprise nous fournira une sorte d’échafaudage mental, guidant nos intentions en façonnant notre contexte informationnel. Il s’agit de prendre l’idée de tutelle et de l’installer dans l’infrastructure de la pensée.
Mais cet effort a plus ou moins échoué, en raison de la prolifération de voix non autorisées sur Internet. La pandémie a suscité des efforts maladroits de reprise en main, qui se sont souvent retournés contre eux.
Si l’on prête à la « santé publique » une quelconque cohérence intentionnelle, on peut supposer que la confusion qu’elle a semée était un effet involontaire de l’approche de la modification du comportement comme un problème de théorie des jeux. Dans la théorie des jeux, on part du principe que les gens sont des personnes intéressées qui maximisent leur propre utilité et on essaie de les manipuler en se basant sur cette prémisse, ce qui est parfois mieux accompli en envoyant des signaux trompeurs. Par exemple, au début de la pandémie, on nous a dit que les masques ne fonctionnaient pas, parce que la priorité était de préserver un approvisionnement rare en masques pour les travailleurs de la santé. Plus récemment, les risques relatifs du virus par rapport au vaccin pour différentes catégories démographiques ont été rejetés comme non pertinents, dans le but de combattre l’hésitation à se faire vacciner. Mais de telles tromperies, aussi bien intentionnées soient-elles, ne peuvent réussir que si l’on contrôle le flux d’informations. Ainsi, dès que vous vous engagez dans cette voie qui consiste à s’écarter de la vérité, vous vous engagez dans la censure et l’application rigoureuse de la narration, ce qui est très difficile à faire à l’ère d’Internet.
Les absurdités du théâtre COVID pourraient être considérées comme une reconnaissance tacite de cet état de fait, tout comme le théâtre de la sécurité a indiqué un nouveau compromis politique après le 11 septembre. Dans ce compromis, nous avons accepté l’impossibilité d’ancrer nos pratiques dans la réalité. Nous nous soumettons à des bureaucraties ossifiées telles que la TSA, qui sont devenues des groupes d’intérêts autoprotégés. Elles peuvent s’étendre mais jamais se contracter, et nous devons prétendre que la réalité est telle qu’elle justifie leur existence. Le Covid est susceptible de faire pour la santé publique ce que le 11 septembre a fait pour l’État sécuritaire. Lorsque nous traversons un aéroport, nous enlevons toujours nos chaussures – parce qu’il y a vingt ans, un clown a essayé de mettre le feu à sa chaussure. Nous nous soumettons à l’irradiation et au pelotage, aussi souvent que possible. On essaie d’oublier des faits tels que celui-ci : lors d’audits indépendants de la sécurité des aéroports, environ 80 à 90% des armes passent sans être détectées. La machine à micro-ondes présente une image imposante de la science qui nous aide à enterrer de telles connaissances. Nous avons le devoir de procéder à une introspection ascétique, en recherchant les dernières tendances à la fierté rationnelle et au respect de la vérité, et en les soumettant à l’analyse. De même, l’irrationalité des règles du Covid auxquelles nous nous conformons est peut-être devenue leur principal intérêt. En nous y conformant, nous promulguons les nouvelles conditions de la citoyenneté.
Source : https://unherd.com/2021/10/the-new-covid-despotism/
Article traduit par Arthur du Réveil des Moutons